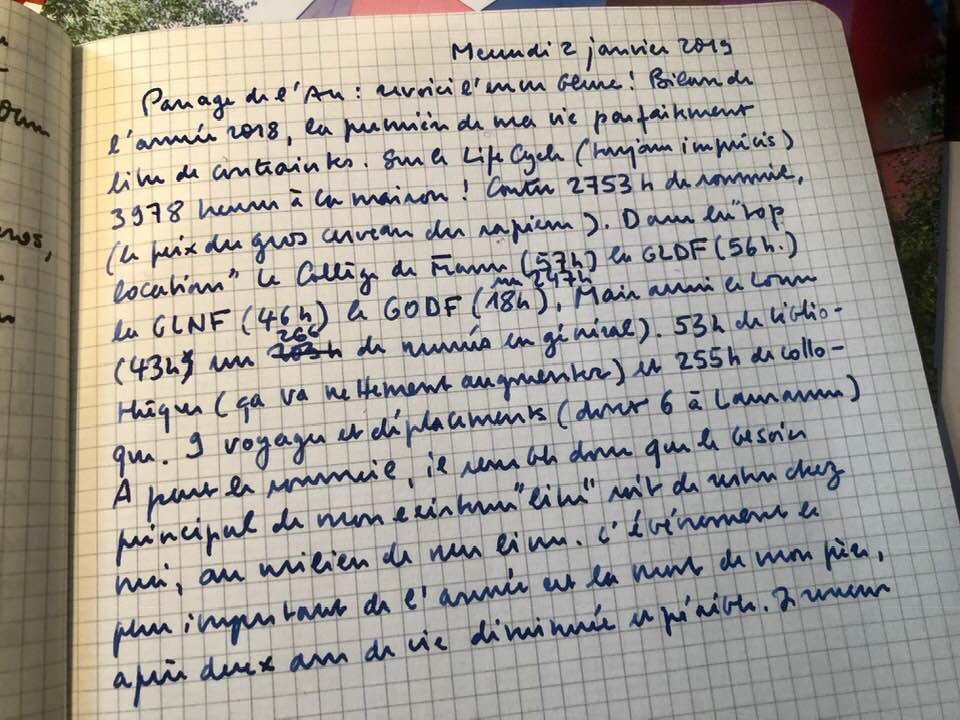14 octobre 2018
Hier après-midi, par une radieuse journée, colloque du Cercle Ferdinand Buisson au Centre Universitaire méditerranéen de Nice, cher à Paul Valéry, dans les années 30. Au programme, Islam et laïcité (on devrait écrire : « islam », car il s’agit de la religion et non de la civilisation, seule porteuse légitime de la majuscule). Mauvais départ : M. Clément Stora, dans une caricature de leçon de philosophie, reprend le thème usé jusqu’à la corde de la sortie de la Selbstverschuldeten Unmündigkeit de Kant (que l’on pourrait traduire par « coupable immaturité »), la définition des Lumières dans le célèbre article de 1784, Was ist Aufklärung ? Mauvais départ, car, en se faisant une idée absolue de la liberté de conscience, il place son interlocuteur dans l’impossibilité absolue de reconnaître une religion quelconque, sous peine d’être considéré comme un « mineur immature », face à l’adulte parfait et purement rationnel qu’est le professeur. En effet, toute religion est une tutelle, qui impose des obligations relevant de l’imaginaire ou du symbolique, et par conséquent irrationnelles. Si on peut consentir librement à cette tutelle, et faire de ses obligations ses propres maximes, il n’en reste pas moins qu’elles ne sont pas et ne pourront jamais être tirées de la raison pure. On sait que les Lumières ont déplacé Dieu du Ciel, où il s’ennuyait fort en attendant la fin du monde, pour le replacer dans la Morale (à titre de postulat) et surtout dans la Nature (panthéisme). Mais M. Clément Stora ne va pas si loin et, ne faisant pas de la laïcité ce qu’elle est, un principe de politique, il se retrouve dans la position du « bouffeur de curé », dont il faut tout faire pour distinguer la laïcité. C’est un grand problème en effet : si la laïcité est faite pour faire vivre ensemble croyant et incroyants, ces derniers ne peuvent commencer par traiter les interlocuteurs de « mineurs immatures ». Il faut admettre a priori la légitimité de la religion en tant que réalité humaine et sociale, reconnaître qu’on peut être à la fois adulte et religieux, pour établir les règles de coexistence qui enlèvent à la religion son dard, et la rendent ¬inoffensive pour l’humanité. Or, me semble-t-il, l’humanité ne semble pas aimer les religions « sages » et « tendres ». La pente des religions tend presque naturellement à la violence : le catholicisme tend à l’intégrisme, le protestantisme tend à l’évangélisme, le judaïsme aux débordements nationalistes et, bien sûr, l’islam à l’islamisme. D’où la grande tentation, en France, d’abandonner la distinction entre islam et islamisme, et de glisser ainsi vers le nationalisme et le racisme, en faisant de la République qui a toujours eu une vocation universelle, une particularité française. Je dirais même que cette précieuse distinction entre islam et islamisme est tout ce qui conserve le discours politique dans le cercle de l’humanisme et de la Gauche. Mais il ne faut pas se cacher que, dans sa longue histoire, la « Fille ainée de l’Église » n’a jamais laissé les autres religions s’établir dans le Royaume : elle a brûlé les cathares, banni et raflé les juifs, banni et persécuté les protestants. Le seuil de tolérance semble se situer autour de 10%, seuil que les musulmans ont désormais, semble-t-il, atteint. Le pire scénario, pour le futur proche, serait donc une nouvelle guerre de religion sur le modèle de celle du XVIe siècle, pour bannir et pourchasser tous les musulmans. Ce scénario semble irréaliste parce que nous vivons dans des sociétés douces et peu religieuses en apparence. Mais cette « croisade » pourrait parfaitement bien être menée au nom du nationalisme et du racisme, valeur de substitution politique.
M. Mohamed Sifaoui a présenté à Nice une brillante défense de la distinction entre islam et islamisme. Retraçant en journaliste la naissance et la croissance de l’islamisme à partir du salafisme et du wahhabisme, il le distingue avec soin du courant majoritaire de l’islam, tout en reconnaissant que son implantation en France est maintenant forte et durable. Mais il refuse l’assimilation de tous les musulmans aux islamistes. En excellent républicain, il fait appel à l’action de l’État pour favoriser l’intégration. Mais c’est sous-estimer la pente libérale en faveur du communautarisme : il serait si simple de déléguer tout le social, l’éducatif et le médical aux religions, comme dans l’Ancien Régime. Malheureusement pour le libéralisme, qui ne s’est jamais implanté durablement en France, les Français réclament manifestement le retour de l’État, dans les territoires en particulier. Ayant échoué sa décentralisation, la République ne peut plus ni avancer ni reculer. Elle n’a plus les moyens de venir au secours de la société, mais refuse de lui donner les moyens de son autonomie, contraire à sa Constitution. D’autre part, la société française refuse de plus en plus manifestement de consacrer l’action de l’État aux immigrés, ce qui est pourtant le seul moyen d’obtenir une meilleure intégration. En Europe, deux seuls pays on fait reposer la citoyenneté sur l’école : la France et l’Angleterre, la plus pure République et la plus pure Monarchie ! Mais l’école républicaine est pour tous, et l’école anglaise pour très peu. Le refus de l’école française par les musulmans est sans doute le plus grand problème actuel de l’intégration. Mais l’État au lieu de s’emparer du problème préfère abandonner les « territoires perdus » au profit des formations « classiques ». Comme si la République pouvait se suffire des grandes écoles, où les futurs dirigeants, formatés par l’économie politique, vont continuer de penser que la consommation résoudra tous les problèmes. Et que les religions sont douces.
12 novembre 2018
Peut-on parler d’une « dépression française » comme le fait Michel Crépu dans son livre sur Chateaubriand ? En tournant le dos à la monarchie (projet de Chateaubriand, qui aurait pu réussir comme il a réussi ailleurs en Europe) autant qu’à la démocratie (qui vous laisse tranquille), la France a fait le choix de la difficulté : la République exige du citoyen un dépassement constant de l’homme dans sa bête réalité (j’allais dire même identité). Il y a quelque chose de l’idéal maniaque dans la République : le sentiment de trahison est presque constitutif du modèle, dont les symptômes vont des fiches à la Terreur. Mais l’idéal républicain, si mal compris en Europe, a aussi produit en France une humanité brave et courageuse, ouverte et sensible, qu’aucun autre régime n’aurait pu établir (la monarchie avilit et la démocratie abrutit). Certes, la République a ses petits problèmes : la présidence est guettée par les dérives monarchiques (Benalla fait penser à un affranchi impérial, à la cour de Néron) et ses dérives démocratiques (montée du populisme identitaire). Dépression non — mais certainement peur de la dépression, qui pousse à la radicalité alors qu’on aurait tant besoin de modération et de douceur, pour rassembler au lieu de diviser.
12 novembre 2018
Paris Photo Fair : noyé sous les images dans les avenues du Grand Palais, alors que j'ai tant besoin d'ordre, dans ce domaine de l'art dont l'histoire n'est pas encore bien établie, même si les « classiques » en apparaissent déjà clairement. La critique et la recherche, en effet, mettent à nu les structures et dégagent le squelette, en se débarrassant de la profusion boursouflée. Mais en déambulant avec tant d'autres dans la Foire, pardon la Fair, on peut rétablir une forme de critique spontanée, inculte, qui est l'admiration : quel que soit son format, son âge, sa couleur, son genre, ses valeurs, une photo vous arrête dans votre progression bousculée. La belle photo s'impose à l'attention flottante, on écoute autant qu'on voit : le silence s'établit, la foule disparaît. On est absolument seul, pour un instant.
6 décembre 2018
Hier à la Sorbonne, pour deux « Controverses Descartes » organisées avec le soutien de la maison d’édition Nathan et la Fondation SNCF pour les profs français. La première portait sur la conciliation de la laïcité et de la spiritualité à l’école (à l’heure où s’effrite la première et où ne se montre pas vraiment la seconde). Delphine Horvilleur, rabbin(e) libérale, commença très fort en affirmant que « la spiritualité, c’est du vent », et en continuant sur le souffle divin et la glaise humaine. Son attachement à la laïcité se faisait le prolongement logique de la nature dialectique du rabbinisme. Mais pourquoi y a-t-il si peu de juifs, et surtout de libéraux ? — c’est que la seule chose qui donne de l’esprit à la religion, c’est d’être minoritaire. Mais, à ce stade, on ne voyait pas encore arriver l’école.
Elle se présenta pourtant avec la nostalgie de la compacité exprimée par Jean-François Colosimo, directeur des Éditions du Cerf, qui eut le don de m’énerver : la rengaine sur nos enfants « exclus du musée européen » par la perte de l’Histoire sainte et du consensus tout-catholique (avec pointes sur l’évangélisme et l’islam). En fait, si nos élèves ne savent plus comment finit l’histoire d’Adam et d’Ève (expérience authentique : M’sieur, ça finit comment ?) c’est surtout parce que le catéchisme et l’histoire biblique se sont enlisés dans le prêchi-prêcha moral et biomoral (assumons le néologisme) au lieu de se mettre au service du mythe.
Si nous avons pu/dû introduire les religions à l’école (enseignement d’option complémentaire dans la Maturité suisse), c’est bien parce que l’Église est devenue inaudible, par son embarras sexuel d’abord — et c’est le cas autant pour les protestants vaudois que pour les catholiques français. Jean-François Colosimo se moque ensuite de l’Histoire des religions, parce qu’elle ne sait pas définir son objet. Comme si la théologie faisait mieux, entre le marécage analogique et les pirouettes dialectiques. En fait l’objet de l’Histoire des religions, c’est d’abord l’imagination humaine, tout simplement — un objet, certes, plus vaste que Dieu, et même que tous les dieux, mais bien situé dans l’anthropologie. Et c’est de ce ressourcement dans l’imaginaire que les (ou certains) élèves ont besoin, avec suffisamment de critique pour en rire, mais assez de proximité pour en jouir.
Et c’est pourquoi le magnifique discours philosophique d’Abdennour Bidart, fondé sur les sources de la raison Socrate et Descartes, mais ouvert aux autres cultures philosophiques du monde, ne me semble pas suffire : quand on aura lu en classe les livres sapientiaux de la Bible, le Coran, la Bhagavad-Gîtâ, le Tao-tö-king, etc., aura-t-on fait une place à la spiritualité ? Si l’approche est trop scolaire, la réponse est non.
Le dernier paradoxe de la journée fut apporté par Philippe Meirieu, qui osa présenter des passages de l’article «Prière » du Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, dans l’esprit du meilleur protestantisme libéral : «Qui nous rendra, qui rendra à nos fils et à nos filles la poésie dont l’âme ne se passe pas, ni celle de l’enfant, ni celle de l’homme ? Qui éveillera chez l’enfant une idée plus pure du devoir, une ambition plus noble ? ». Il y a du dandysme à révéler que Ferdinand Buisson n’était pas matérialiste à un auditoire de marxistes et de positivistes, au milieu de la France des gilets jaunes.
La seconde table ronde devait poser la question : qu’est-ce que l’école peut attendre des neurosciences ? Après une tranche soporifique de naturalisme dogmatique et de sociologie compacte servie par Joëlle Proust, un sympathique et décontracté pédopsychiatre, Bernard Golse, vint nous dire que le cerveau étant si peu prévisible, la construction du savoir épigénétique étant si variée, on ne pourrait pas tirer grand-chose des neurosciences, si ce n’est le rappel que la relation est importante dans l’apprentissage. Olivier Houdé, successeur de Piaget en Sorbonne, vint nous présenter son livre des éditions Nathan, et nous rappeler sa belle carrière académique. Enfin le bon sens prévalut avec le psycholinguiste Franck Ramus, qui affirma qu’une solide formation en Psychologie et Sciences de l’éducation suffirait longtemps pour enseigner, même si les neurosciences étaient très amusantes pour les chercheurs. Bref, le contraire de ce que veut faire croire le ministre aux gogos : les neurosciences ne pourront contribuer à la conduite des classes et faciliter l’apprentissage avant longtemps. D’ailleurs, le ministre dûment annoncé n’est pas apparu.
7 décembre 2018
Ce matin, je conduis mon petit-fils à l’école. Paris se met au travail sous la grisaille : livraisons, nettoyages, déménagements. Et j’admire, non seulement ces grandes avenues qui montrent l’Arc de Triomphe martyr des casseurs au fond de la perspective, mais surtout l’ensemble des dispositifs urbains cachés qui permettent la civilisation : hydrauliques, électriques, informatiques, alimentaires, scolaires, etc. Se peut-il que l’on ressente de la haine envers tout ce travail, qui se condense et culmine, comme l’avaient vu Poe, Baudelaire et Benjamin dans les vitrines des beaux magasins ? Les forces de production peuvent-elles vraiment sacrifier, au nom de la lutte contre le fétichisme, le produit de tous leurs efforts ? J’ai toujours ressenti que la barbarie existait, malgré le beau discours de Lévi-Strauss à l’UNESCO (« Le barbare est celui qui traite les autres de barbares »). Eh bien non, je sais que le vandalisme existe et qu’il est inexcusablement barbare (même le vandalisme des parpaillots — les graffitis des lansquenets sur les fresques de Raphaël — même le vandalisme de la Révolution française — détruire Cluny !). La splendeur de la civilisation n’appelle pas chez tous la joie et le bonheur. L’envie, le ressentiment, la haine des gauchistes pour le « capitalisme » doivent dire son nom : c’est la pulsion de mort, la haine de soi, la pulsion suicidaire. Freud me revient donc à l’esprit : nous vivons, à la veille d’un nouveau siège de Paris, un moment freudien : le malaise dans la civilisation, dont les contraintes sont trop lourdes pour tous ceux qui veulent faire vroum-vroum le plus vite possible, tuer des animaux impunément, exprimer publiquement leur racisme, leur sexisme, leur homophobie, etc. Paris Match fait une couverture où dialoguent un vieux gilet jaune et un jeune CRS : manque de chance, le personnage est un antisémite notoire, condamné par la justice. La grimace sous le gilet.
11 décembre 2018
Comment le pouvoir peut se casser entre les mains de son détenteur : Macron, hier soir, semblait se nourrir de la haine que lui porte la France. Il me semble en effet que, si nombreux que soient ceux qui ne savent plus vers qui d’autre se tourner, plus personne ne l’aime. Ce désamour avait frappé Giscard en son temps, puis Sarkozy (très vite), puis Hollande (à cause de sa vie privée, si implacable). Mitterand et Chirac ont pu être détestés (ils étaient détestables, par bien des aspects) mais n’ont jamais été désaimés. Avec Macron était apparu le prodige, l’enfant mystérieux (retour dans le réel de l’enfant merveilleux du narcissisme primaire) dont la jeunesse et les succès devaient se transfuser à tout le pays. Mais sa politique outrageusement injuste en faveur des plus riches (« Plus de milliardaires en France », etc.) a fini par provoquer le retour du refoulé : les millions de malheureux sur lesquels l’État comptait pour équilibrer son budget sont sortis de la périphérie où ils avaient été relégués pour venir casser Paris. Ce n’est pas que la France tienne tant à l’équilibre du budget : elle est restée royale en cela, et, dans l’inconscient national, templiers, juifs, Lombards seront toujours là pour payer la facture de Philippe le Bel ! Les prêteurs se pressent au portillon, et le poids de ces charges inutiles que sont la justice, l’hôpital, l’école, etc., ce « pognon de dingue », tout qui ne sert pas à parader et à « représenter », comme dit Montesquieu, peut toujours être restreint jusqu’aux limites de la rupture (Ah cette fameuse vaisselle...). Non, la France s’accommode étonnamment de la misère de sa justice, de la surcharge de ses hôpitaux, de l’effondrement de son école publique, de la minceur de ses retraites, etc. Mais l’équilibre budgétaire est un argument en Europe, auprès de ces pays du Nord qui ne supportent pas les déficits, ayant le culte si bourgeois du fameux « Schwarze Null ». Et puisque l’Allemagne perd la main en Europe, ébranlée à son tour par le nationalisme et le populisme, la France peut croire qu’elle a une partie à jouer : toujours ce rêve français de l’« Europe-puissance », que personne ne partage en Europe. Macron, hier soir, devait choisir de sacrifier aux pauvres les riches ou l’État : nous voyons que toutes les mesures annoncées seront aux frais de l’État. Les riches sont sauvés, et l’inégalité pourra continuer imperturbablement de croître en France une nouvelle fois. À tous ceux qui attendaient un peu de compassion, un peu de contrition, un peu de justice, Macron a opposé une tête de sale gamin obligé de s’excuser, surjouant l’humilité qu’il ne ressentait pas, en se réjouissant d’avoir joué un sale tour à ses maîtres. Tout était faux dans son maintien, son attitude, son élocution (coupez le son et vous le verrez clairement). Ses promesses et ses concessions (si maigres) lui arrachaient la bouche, et il rayonnait de mauvaise volonté en suivant le prompteur.
27 décembre 2018
Il y a une métaphysique du gilet jaune : cet objet disgracieux, imposé par la sécurité routière, est devenu un symbole de la citoyenneté et de la prise de parole de catégories sociales qui, semble-t-il, n’avaient jamais voté (ni même pensé à autre chose qu’eux-mêmes). Mais la lumière qui se reflète sur les gilets jaunes est toujours une lumière d’emprunt : elle provient de l’adversaire (médias, pouvoirs, etc.). Le gilet jaune signale une présence fragile à la machine qui fonce dans la nuit, elle témoigne d’une humanité en danger aux lisières de la disparition. Ainsi, c’est toute la fragilité humaine qui apparaît de manière dépendante et précaire. Il faudrait être Giorgio Agamben pour parler de la « sacralité » du gilet jaune. Et Lévinas, pour en faire le « visage » du passant anonyme qui chemine obscurément. Pour qui avance avec sécurité dans la nuit, fort de sa motorisation et de son éclairage puissant, apportant sa propre lumière à son chemin, le gilet jaune signale la fragilité toujours exposée de l’humain.
Ainsi dans la polarité politique, la partie « haute » (le prince) qui détient la lumière (forces, argent, médias — en France, les ors des palais républicains) est-elle appelée à prendre soin, ou garde du moins, à l’existence de la partie « basse » (le peuple), qui ne peut que « réfléchir » la lumière de la richesse et de la notoriété, comme ces visages qui regardent les dîneurs, dans le grand hôtel de Balbec. De même, le rond-point, lieu par excellence de la fluidité anonyme, plus ou moins hideusement et ridiculement décoré, peut se transformer en nouveau forum citoyen, où s’exprime la misère des dépossédés, mais aussi le retour à l’échange et donc à la dignité (et même à l’amour, selon certains). Ainsi l’emblème de la circulation la plus stupide et la plus morne peut-il être retourné en île déserte où vient se renouer le pacte social. Une théâtralité politique nouvelle émerge de la réutilisation des décors de la vie sociale. J’attends les films, les pièces, etc. On va bientôt jouer Carmen et la Traviata en gilets jaunes sur un rond-point.
Mais cette obscurité, dans laquelle s’est engloutie une partie de la population européenne (la crise n’est pas que française, les symboles circulent), ces « périphériques » détectés par le géographe Guilluy (meilleur géographe que penseur politique, d’ailleurs) représentent aussi une sorte de compensation, ou de mouvement en retour par rapport à l’exode rural des années glorieuses. Dans le grand vide des « territoires », tous ces villages, bourgs, petites villes, que l’on traverse en frissonnant et où tout est à vendre, s’est formé un grand asile de la précarité sociale, où l’on peut vivoter en paix, dans un décor encore rural et sous un beau soleil, dans une grande nature, loin de la pression de la socialité réelle, avec un chien et un vieil ordinateur pour injurier tout le monde et recevoir des photos des enfants. Mais ces nouveaux Robinson de la périphérie ont gardé un fil au pied : ne sachant plus marcher des jours entiers comme leurs ancêtres, ils ne peuvent se passer d’une voiture, même petite, sale, pourrie, mais toujours vulnérable au prix du carburant. Dans ce mouvement social, nombreux sont ceux qui ont remarqué qu’on ne demandait pas plus, mais moins : d’impôts, de taxes, d’amendes, etc.
Mais c’est peut-être justement le caractère soustractif de ce mouvement qui crée le vide où s’engouffrent tous les fantômes totalitaires du siècle passé, et tous ceux qui n’ont jamais digéré 1945 et 1989. Les idéologies mortifères et suicidaires, qui n’ont plus de prise sur la société, retrouvent la parole dans la crise ouverte par un mouvement sans structures ni représentants autorisés. Ce mouvement qui est tout sauf une révolution, porté par le déclin de la société et sans la moindre utopie, voit revenir toutes les sottises qui ont accompagné sans égarer ma jeunesse : cette idéologie qui proclame que si le splendide Moi que je suis réellement n’est que moi (inculte, grossier, bête, banal, seul), c’est que le Système et le Pouvoir (si on parle de Domination, on entre carrément dans la théologie) m’ont aliéné de ma Vie « générique » au profit de la Marchandise. Et la « casse » et la « fauche » sont donc légitimes pour briser le « fétichisme » et restaurer la virginité originelle des forces productrices, capturées dans les filets des rapports de production. Et c’est ainsi que la capitale européenne de la Beauté est mise à sac sous les yeux du monde entier. Mais il y a des jours où il faut savoir défendre l’œuvre contre le créateur, et toutes les petites choses qui sont sorties des mains et de l’esprit de l’homme en sept millions d’années contre le gorille toujours mutant qui les a tirées de la nature. Et j’écoute donc, atterré, les cris de haine de Claude Askolovitch, que je vois se transformer en rhinocéros gauchiste comme chez Ionesco. Mais ne craignez rien, ce juif honteux n’ira pas jusqu’à se faire casser la gueule dans un rond-point.
29 décembre 2018
Je crois avoir suivi longtemps l’actualité littéraire, et même avoir publié des centaines d’articles et de compte-rendu, mais je n’aime plus ce qui s’écrit aujourd’hui, et surtout se publie (car on ne sait jamais ce qui s’écrit maintenant, à l’insu de tous : une Recherche fiévreuse dans une chambre étouffée, ou des Mémoires de Saint-Simon, tranquillement à la campagne). Toujours dans le Magazine littéraire de janvier 2019, on a sollicité huit écrivains contemporains, une vieille potiche toujours alerte, et un économiste donneur de bons conseils (tiens, ce n’est plus le rôle des psychanalystes, et encore moins des philosophes). En lisant François Beaune, Arno Bertina, Dan Franck, Nathalie Quintane, Marc Weitzmann, Arnaud Viviant, Aurélien Bellanger, Charles Pennequin, je décide de me plonger dans le bain littéraire contemporain. Et j’en ressors avec le même ennui : tout cela est d’abord misérabiliste, comme s’il appartenait désormais à la littérature de constituer ce discours mineur appelé naguère par Deleuze & Guattari à propos de Kafka : « I embrace the common, the familiar, the low » disait Emerson dans L’American Scholar. Aujourd’hui au fond, ce mot d’ordre a été trop bien entendu. Pour revenir au sublime, il faut s’enfoncer dans le passé, même récent. Que n’a-t-on Hemingway sous la main, pour l’envoyer sur un rond-point (il s’y serait précipité d’ailleurs), mais pas nos auteurs visiblement ! Second grief : tout ce qui s’écrit aujourd’hui est narcissique, surtout quand l’écrivain peut faire montre de sa banalité et de sa misère. Et finalement, tout est victimaire : dans la Marseillaise vandalisée de l’Arc de Triomphe (et pas Marianne !), on veut voir en miroir une image des victimes éborgnées par les tirs de flash-ball. Certes, mais pour refaire la barricade des Misérables, il faudrait une armée qui tire et qui tue. Bref, pour revenir au beau et au sublime, il faudra attendre que le Saint-Simon de la Nuit debout, de la ZAD des Landes, de Mai 2018, des Gilets jaunes, etc. ait fini son travail et publié ses mémoires. Pour l’instant, je l’imagine riant tout seul dans un grand appartement haussmannien ou une maison au bord de l’eau, ni misérabiliste, ni narcissique, ni victimaire, mais travaillant à projeter tout son temps dans l’éternité, répartissant justement tous les contemporains en enfer, au purgatoire, ou au paradis.
2 janvier 2019
Retard de lecture : je retrouve englouti sous une pile le numéro 201 du Débat (septembre-octobre 2018). On s’y interroge encore sur la nature du « macronisme » en se demandant si le Centre peut être le parti du Mouvement, rôle plus traditionnellement endossé par les extrêmes. Quelques mois plus tard, les Gilets jaunes ont répondu à la question : Macron n’est qu’un vulgaire « oligarque libéral » comme les autres. En quelques semaines, l’opinion publique s’est habituée à ne plus rien attendre de lui : le moment de grâce semble passé, et l’intéressé lui-même semble désarçonné, comme tous les surdoués devant l’obstacle d'une résistance inattendue. Il est vrai que la tâche principale d’un PR consiste d'abord à emprunter de l’argent, et donc à rassurer les créanciers. Beaucoup de gens pourtant le soutiennent encore, par fidélité à leur vote de l’an dernier. Mais si la nation est bien un « plébiscite permanent » (Renan), il n’en va pas de même du PR. On me demande : pour qui votez-vous ? Je réponds que je n’ai pas à voter jusqu’en 2022, et que j’aviserai alors. Qu’était Macron en 2013 ?
Dans le même cahier du Débat, un dossier sur tout ce qu’il fallait commémorer en 2018, et qui l’a été si mal. Occasions ratées de « Grand débat» :
- 1848 d’abord, cette révolution ratée, prise en tenaille entre le mépris de Marx pour le « socialisme utopique » et la terrible description de Flaubert dans L’Éducation sentimentale. Et pourtant, il y a quelque chose à sauver dans l’idée de Proudhon : on ne change pas une société par l’État. La partie en retour pourrait valoir à Marx un nouveau revers historique (il n’a connu que des échecs politiques). Il aurait fallu parler plus amplement de 1848.
- 1918, ensuite. On aurait dû parler enfin de la victoire populaire et démocratique contre les empires et les aristocraties, mais l’Armée française a choisi de célébrer plutôt les « huit maréchaux » (avec Pétain dans un premier temps du moins), c’est-à-dire les vieilles ganaches qui ont envoyé les autres à la mort en passant de château en château (ô les Sentiers de la gloire).
- 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme, fondement de nombreuses cours et institutions en Europe et dans le monde. Aujourd’hui fort combattue par les démocratures illibérales (les mots de l’année), et aussi par tous les populistes, souverainistes, racistes, suprématistes, indigénistes et « féministes islamiques ».
- 1958, la constitution gaulliste tant déformée par le présidentialisme qu’on ne sait plus comment la démocratiser alors qu’il suffirait d’en revenir à sa lettre, tout insuffisante qu’elle soit en termes de séparation des pouvoirs, de représentation nationale, d’autonomie des territoires, etc.
- 1968 enfin, cinquantenaire très embarrassé sur lequel pèsent les casseurs, et les zadistes occupant Jussieu. Et pourtant, les Français savent ce qu’ils doivent à cette Révolution culturelle qui les a libérés du « Travail Patrie Famille » qui régnait encore dans ma jeunesse.
Jean-Noël Jeannenay revient sur l’« Affaire Maurras » en faisant la distinction, encore une fois, entre célébration et commémoration. Cet incroyable cafouillage au plus haut niveau a vu la démission en bloc de la Commission des « célébrations » nationales, en réaction au démenti de la ministre, qui avait pourtant préfacé le rapport de la Commission, elle-même ensuite démentie par le PR. En fait on voit toute la sacralité irréductible cachée dans le mot « commémoration » qui ne renvoie pas à des études objectives « l'Histoire critique », mais encore et toujours à l’« Histoire monumentale » dont parlait Nietzsche.
16 janvier 2019
Le grand thème du populisme mondial : effacer le progressisme. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Durant une cinquantaine d'années, d'énormes progrès ont été faits par l'humanité occidentale en matière de refoulement : vitesse, fumée, violence, abus sexuels, pédophilie, discours sexistes, antisémites, racistes ont été censurés, pour le plus grand bien de l'intégration sociale (la libido au sens de Freud). Mais il semble que le refoulement ait atteint une limite, et le populisme représenterait le retour du refoulé, donc un danger pour la civilisation en général, à laquelle l'individu opposera toujours son ambivalence fondamentale, qui trouve son expression dans le complotisme.
10 février 2018
C’est curieux, chez les sociologues, ce besoin de mal finir : pourquoi les meilleurs observateurs de la société sont-ils si fortement attirés par la radicalité politique, donc par la destruction de leur objet ? Récemment, le démon de la sociologie a encore fait tomber Todd dans la mélasse et Guilluy dans la farine. Souvent de « basse et petite extrace », (sauf Todd) les sociologues seraient-ils emportés par le ressentiment ? Est-ce le ressentiment lui-même qui fait voir les inégalités et pousse à les décrire ? Une société, c’est d’abord une stratification, même si elle reste inconsciente et invisible pour la majorité des acteurs. L’égalité se fait par l’État, par la politique. Mais lorsque l’État, débordé par les pressions de la société inégalitaire ou simplement accaparé par le souci de ses dettes et déficits, néglige programatiquement de satisfaire au besoin naturel d’égalité, la société se fâche et rétablit un semblant d’égalité en sacrifiant les plus riches, ou par une catastrophe qui nivèle les conditions et les patrimoines, ou du moins en réduit l’écart. Ceci est également valable pour le patrimoine symbolique : dans une société très inégale culturellement, on assiste à un engouffrement dans la bêtise et la violence. Les spécialités les plus pointues et les arts les plus fins côtoient les trolls les plus épais. Mais le sociologue, le meilleur connaisseur des inégalités, le professionnel de leur mise en valeur scientifique, pourquoi est-il comme obligé de courir prendre les Bastilles ?
18 février 2019
Exaspéré par les pinaillages de tous bords sur l'antisémitisme : je considère le racisme, et donc l'antisémitisme, comme le Mal absolu. Donc, je vais marcher demain avec tous ceux qui seront là, et donc d'accord, même un peu, avec cet axiome. Les Gilets jaunes sont racistes ? Tant pis pour les Gilets jaunes. Les musulmans sont racistes ? Tant pis pour les musulmans. Les communistes sont racistes ? Tant pis pour les communistes. Les nationalistes sont racistes ? Tant pis pour les nationalistes. Le néolibéralisme n'est pas raciste ? Tant mieux pour le néolibéralisme. Les classes dirigeantes ne sont pas racistes ? Tant mieux pour les classes dirigeantes. Macron n'est pas raciste ? Tant mieux pour Macron. On ne fait pas de la politique avec de la pureté, mais avec des principes clairs. Et pourtant demain, j'avais les vernissages du Musée Guimet, la conférence de Michel Delmas sous les auspices du CLR, la conférence de mon TCF Rauzy au GODF, le TRGM de la GDLF à la Sorbonne, Don Quichotte au Royal Ballet, etc. Et j'ajoute que je déteste piétiner dans le froid, et que je considère que toutes les manifestations sont inutiles. Et pourtant, il faut marcher... parce qu'exaspéré par les pinaillages.
4 mars 2019
Le génie des titres : Les Fleurs du Mal devaient s'appeler Les Lesbiennes, et Sodome et Gomorrhe, La race des tantes. On imagine le Ministère annoncer le nouveau programme de Français pour les lycées, destiné à conforter un classicisme de bon ton, de "reprise en main" de l'école : d'abord Montaigne (les aristocrates doivent éduquer les bourgeois, pour leur donner du style), ensuite La Fontaine (les bourgeois doivent éclairer les prolétaires, pour les rendre plus libres), puis Le Rouge et le Noir (qui figure sur la photo officielle du Président de la République), puis Les Lesbiennes de Charles Baudelaire et La Race des tantes de Marcel Proust.
17 mars 2019
Certes, le temps n’est plus où l’on pouvait faire connaissance sans difficulté, au Salon du Livre de Paris, avec des personnalités comme Joaquim Vital, Hubert Nyssen, ou Yves Bergé, comme cela m’est arrivé il y a trente ans. Aujourd’hui, sur les grands stands, quelques auteurs en signature provoquent des attroupements, et de pauvres petits étudiants cherchent des titres illustres sur des ordinateurs indociles, pour satisfaire une clientèle plus éclairée qu’eux. Sur les stands régionaux, cependant, on peut encore rencontrer de vrais éditeurs, comme Claire Paulhan et Colette Lambrichs, et goûter brièvement, partiellement l’esprit de bouteille à la mer de l’édition encore quelque peu aventureuse. J’ai dit combien l’Éditeur, entrepreneur du livre, avait été prescripteur à la fin de l’empire de la Critique. Mais la pulvérulence de l’autoédition et le morcellement du lectorat, — et de la société d’ailleurs par-delà la seule lecture, — ont mis fin au règne de l’Éditeur, dont les couvertures ne prescrivent plus rien, même pas au libraire.
Et puis, dans le Salon du Livre, il y a les conférences. La chance d’écouter un esprit de la taille de Peter Sloterdijk répondre aux questions d’actualité n’est pas à négliger. Il vient de publier sur l’Europe, et défend un point de vue très allemand, qui n’est pas très bien compris en France : la chance de l’Europe, c’est sa « médiocrité », dit-il. En champion toute catégorie des raccourcis fulgurants, il évite soigneusement le terme philosophique de « modération » qui fleure bon la Grèce antique et la sagesse, et nous balance ce que nous détestons le plus, la « médiocrité » ! Pour lui, les nations, les entités « psychopolitiques » (encore une synthèse à sa manière), peuvent être mégalomaniaques, déprimées ou « médiocres », et le nationalisme lui paraît la dose nécessaire de mégalomanie destinée à soutenir les déprimés (pas mal visé, Peter Sloterdijk). C’est même dans la mesure où l’Europe ne cherche pas la grandeur qu’elle ne déprime pas trop (pas d’illusion sur le great again). Les réponses allemandes à l’appel de la France ne lui semblent rien d’autre que des mesures destinées à « calmer » ce prurit de puissance. Mais il ne nous dit pas combien de temps l’Allemagne pourra garantir en son sein un consensus suffisant à l’immigration massive, nécessaire pour produire de grosses voitures et payer de lourdes retraites.
Le débat se finit, et sur ce visage du Nord un peu informe, qui aurait pu être brossé par Franz Hals, se dégage enfin la douce lumière des derniers portraits de Rembrandt, où l’art suprême rejoint la plus grande lassitude. Qui donnera à l’Europe les frontières dont elle a besoin, la défense qui la fera respecter de l’Asie, la constitution qui fixera les droits de ses peuples ? Pas l’Allemagne, c’est certain. On ne trouve pas plus chez Habermas, philosophe du Droit, que chez Sloterdijk, philosophe de l’Art, de quoi faire de la politique sérieusement : fixer une législation sociale uniforme pour protéger partout le travail d’abord, donc en finir avec le libéralisme, au moins pour un moment. Depuis quelque temps, je pense que l’Europe a non seulement besoin de frontières, mais de volonté. La « médiocrité » n’y suffira pas.
24 avril 2019
Mon vieux Mont-Blanc Meisterstück, compagnon de ce journal, me crache son encre sur les doigts par tous ses pores, pour se venger d’être resté encapuchonné pendant ce grand mois de visites et de pérégrinations (car il y a des lectures qui sont des voyages). Comme le génie d’Aladin qui, enfermé par le Roi Salomon pendant 3'000 ans dans une lampe scellée, se promet à la fin de tuer celui qui le délivrera, mon noble stylo manifeste son ressentiment en maculant mes doigts. Que voulais-je donc écrire ici, avant de devoir aller me laver les mains ? D’abord un peu pester contre la BnF François Mitterand, son architecture absurde (mon projet : une grande pyramide au bord de la Seine, avec les livres en sous-sol, les lecteurs au rez, les chercheurs à l’étage, et un immense restaurant au sommet), et ses matériaux atroces qui ne s’adoucissent qu’au rez-de-jardin où ne descendent que les « élus » de la recherche et de la lecture. Ma diatribe sera pourtant fortement abrégée : je dois reconnaître que les immenses couloirs vous donnent le sentiment métaphysique de la brièveté de la vie et de la durée nécessaires des grandes lectures (ars longa, vita brevis). Les « grandes lectures », voici ce que je viens chercher ici, et que l’exaltation de la (re)découverte de Paris ne m’a pas encore permis. Sortant de quarante ans d’enseignement, je ressens en effet le besoin de « refaire » mes études de littérature et d’art, avec les grands auteurs du passé. Installé dans la salle V, littérature française, je poursuis l’examen des éditions en libre accès, dont la profusion me comble, sans ressentir encore le besoin de rien faire monter des réserves. Hier, Sainte-Beuve m’a retenu, et non mes lectures présentes (Proust, Chateaubriand, Nodier, Mérimée, que je connais si mal). J’ai toujours aimé perdre mon temps avec Sainte-Beuve, malgré tout ce qu’on peut dire contre lui, et l’absurdité de son projet critique, « l’histoire naturelle des esprits ». Je suis un fils de l’écriture (Barthes) et du texte (Starobinski), Fumaroli m’apporte la tradition aristocratique, complémentaire au culte de la modernité absolue dans lequel j’ai grandi. Thibaudet est mon grand-père littéraire, avec sa solide assise dans la littérature et la politique (il m’apporte l’esprit du début de mon siècle, le 20e siècle). Mais Sainte-Beuve, tout taré et vicieux, reste bien le vieil « oncle » de la littérature française : celui par lequel on apprend ce que les parents vous cachent.
5 mai 2019
Si Marx a raison sur le déterminisme économique, alors il a tort dans toute sa politique : on ne peut rien faire contre le capitalisme, pas plus que contre l’agriculture ou l’industrie, même si la première apporte la faim, la seconde la misère, et le troisième la pauvreté. Les contradictions du système sont épisodiquement violentes, certes, mais cette violence ne débouche sur rien, et paraît ensuite encore plus oubliée par ses victimes que le passage d’un ouragan. Le mythe de la Révolution rejoint au magasin des grandes illusions le mythe du Ruissellement : l’inégalité est produite par les phases de prospérité, et la misère par les phases de récession. Et même la conception opposée, le déterminisme des idées, ne mène pas plus loin : on ne peut pas plus contre les idées déterminantes de son époque que contre le mouvement des choses. Le rôle de l’esprit singulier est donc purement contemplatif : il assiste aux catastrophes, ainsi qu’aux renaissances, d’ailleurs. Tous les philosophes ont tenté de transformer le monde de diverses façons, mais maintenant il s’agit de le comprendre. Pourquoi, si parfaitement convaincu de la vanité de la politique et des intellectuels, ne suis-je jamais devenu pessimiste ? J’ai grandi dans un monde sans grande culture ni grand art, dans une démocratie parfaite qui se mentait sur son histoire, et se croyait abritée des tempêtes de l’histoire, en détestant les intellectuels et les « élites » qui ne partageaient pas les croyances communes (neutralité, etc.). En tant que citoyen actif, et même engagé parfois, j’ai toujours été minoritaire jusque dans mes petites victoires, ne partageant ni les illusions de la Gauche, ni celles de la Droite. La grande culture et le grand art auxquels j’ai eu le privilège d’avoir eu accès très tôt, et le pouvoir de les partager pendant toute ma vie active m’ont rempli de bonheur sans jamais me dissimuler la singularité de ma position. Ma famille même, qui savait que là était le meilleur de la vie, n’en avait jamais fait son mode de vie. Grandir et vivre dans une démocratie parfaite vous permet de vous consacrer avec succès à votre passion, mais vous dispense de l’illusion d’appartenir à une « classe » bien établie, et que votre passion puisse se partager au-delà d’un certain cercle de happy few. Tandis que la profonde mélancolie de considérer à quel point la culture compte peu dans la société appartient bien aux élites républicaines, qui ont cru à la promesse de leurs bons maîtres d’école : pouvoir diriger un jour la société par l’intelligence, la science et la culture. Nos bons maîtres à nous, dans une démocratie parfaite, nous disaient bien que nous serions un jour chargés de diriger la société (ce que je n’aurais pas dit à mes propres élèves), mais jamais ils n’auraient dit, ni même pensé, que ce fût par l’intelligence, la science et la culture. Ils nous préparaient seulement une « arrière-bouticque » à la Montaigne, pour supporter la méchanceté et la bêtise. (Noté ceci en commençant le dernier volume de la précieuse revue Conférence no 47, qui va cesser sa publication).

/image%2F0624814%2F20141013%2Fob_efb0f9_photo-du-24-06-13-a-22-33.jpg)